Les perturbateurs endocriniens (PE) sont partout. Invisibles, discrets mais actifs à des doses infinitésimales, ils interfèrent avec notre système hormonal et suscitent l’inquiétude croissante des autorités sanitaires.
Des substances qui impactent le système endocrinien
Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques — d’origine naturelle ou de synthèse — capables de perturber le fonctionnement du système endocrinien. Ce système, essentiel à l’homéostasie de l’organisme, contrôle la croissance, la reproduction, le développement neurologique, le métabolisme ou encore l’équilibre thyroïdien.
Le mode d’action des PE est protéiforme : ils peuvent imiter une hormone naturelle, en bloquer les récepteurs, ou altérer leur production, leur transport ou leur dégradation. Le tout, souvent à de très faibles doses, ce qui complique fortement leur détection et leur régulation. À rebours des logiques toxicologiques classiques, la relation dose-effet n’est pas linéaire : certains PE peuvent être plus actifs à faible dose qu’à haute concentration.
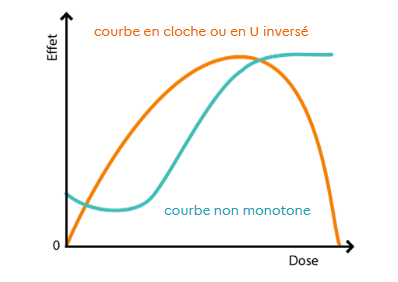
Des chiffres qui inquiètent
Des chiffres relayés par Santé.fr dressent un constat alarmant :
- Environ 800 substances sont actuellement reconnues ou suspectées comme perturbateurs endocriniens par l’OMS.
- En France, 99 % des femmes enceintes présentent des traces mesurables de phtalates, selon l’étude de cohorte ELFE (Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance).
- Les enfants présentent des niveaux d’imprégnation plus élevés que les adultes.
Ces données révèlent une exposition généralisée, constante, et souvent précoce.
D’où viennent les perturbateurs endocriniens ?
Les PE se retrouvent dans des milliers de produits de consommation courante, y compris ceux destinés à des populations sensibles.
➤ Principales substances identifiées comme PE :
| Classe chimique | Matrice de transfert | Substances concernées | Présents dans... |
| Phtalates | DEHP, DBP, BBP, DiNP… | Inhalation | Plastiques souples, jouets, revêtements |
| Bisphénols | BPA, BPS, BPF… | Ingestion | Bouteilles, boîtes de conserve, tickets de caisse |
| Parabènes | Methylparabène, propylparabène… | Contact cutané et ingestion | Cosmétiques, produits d’hygiène |
| Alkylphénols | Nonylphénol, octylphénol | Inhalation et ingestion | Détergents, textiles |
| Retardateurs de flamme bromés | PBDE | Inhalation | Meubles, électroniques |
| Pesticides | Atrazine, glyphosate, DDT | Inhalation, ingestion et contact cutané | Produits phytosanitaires, résidus alimentaires |
| Dioxines et PCB | TCDD, PCB-153… | Inhalation et ingestion | Pollution industrielle, poissons gras |
| Composés perfluorés (PFAS) | PFOA, PFOS | Inhalation, ingestion et contact cutané | Textiles imperméables, emballages, mousses anti-incendie |
Des effets sanitaires avérés ou suspectés
L’impact des perturbateurs endocriniens est désormais bien documenté, en particulier sur les phases critiques du développement (vie fœtale, enfance, puberté) ; les PE sont associés à une variété de pathologies, notamment :
- Troubles de la reproduction : infertilité, baisse de la qualité du sperme, malformations congénitales (cryptorchidie, hypospadias), puberté précoce.
- Cancers hormonodépendants : sein, testicule, prostate.
- Troubles métaboliques : obésité, diabète de type 2.
- Perturbations thyroïdiennes : hypo/hyperthyroïdies, troubles du développement neurologique.
- Effets transgénérationnels : comme ceux observés chez les petits-enfants de femmes exposées au diéthylstilbestrol (DES) entre 1940 et 1970.
La pertinence clinique de ces effets à faibles doses impose aujourd’hui une révision profonde des méthodes d’évaluation du risque.
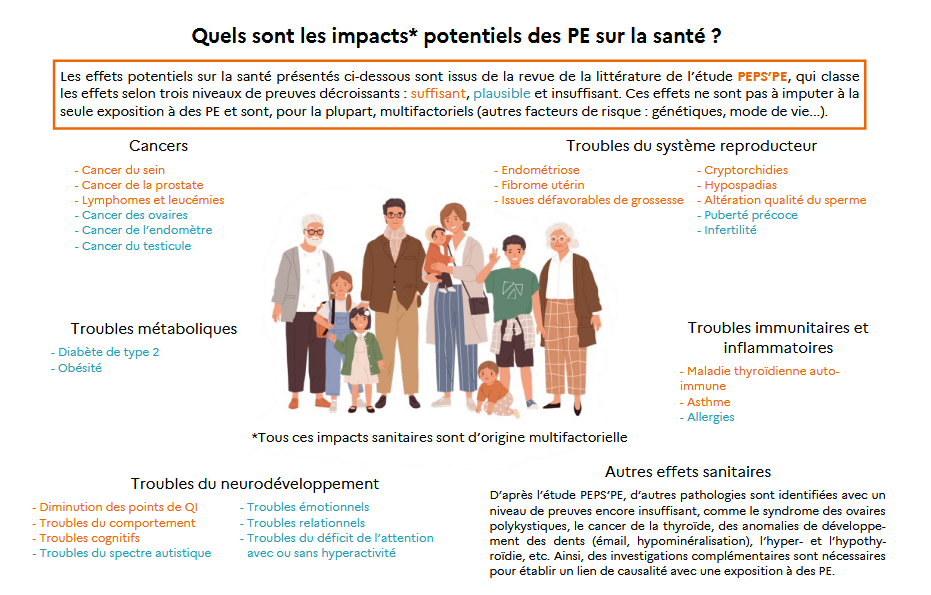
Source de l'image : Mieux comprendre les perturbateurs endocriniens, Anses - Santé Publique France
Vers une approche intégrée : l’exposome
Les scientifiques plaident aujourd’hui pour une approche globale de l’exposition : l’exposome, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs environnementaux (chimiques, biologiques, sociaux) auxquels un individu est exposé au cours de sa vie. Cela inclut la co-exposition à plusieurs PE et leurs effets combinés — encore mal compris.
Des travaux sont en cours pour développer des bio-marqueurs d’exposition, améliorer les protocoles toxicologiques et repenser l’évaluation réglementaire pour intégrer les effets à long terme, à faibles doses, et dans des conditions réalistes d’exposition humaine.
L’enjeu est de taille : protéger les générations futures d’une pollution invisible, mais omniprésente. Le caractère insidieux des perturbateurs endocriniens — faibles doses, effets différés, ubiquité — exige une réponse scientifique rigoureuse et coordonnée.
Titre
En savoir plus

Microplastiques et air intérieur : AtmoSud a développé…

6 gestes à adopter pour réduire son exposition aux PFAS

"60% des pesticides sont des pertubateurs endocriniens"
Pour le toxicologue André Cicolella, les pesticides relèvent d'une pollution chimique où les perturbateurs endocriniens sont centraux.
